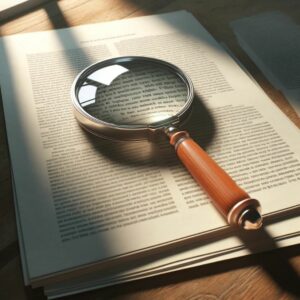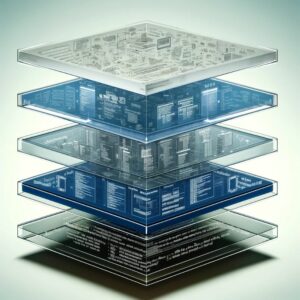L’accessibilité des contenus vidéo en ligne : enjeux et guides pratiques
La consommation de vidéos représente une large partie du trafic sur internet. Chaque jour, de grandes quantités de vidéos au format divers et varié s’uploadent pour satisfaire notre besoin de divertissement ou d’information. Il arrive parfois même que certaines de ces vidéos, notamment celles imposées par le fil d’actualités de nos réseaux sociaux, captent notre intérêt sans que nous ne nous en rendions compte. En effet, ces dernières sont pensées pour toucher le plus large public possible. Néanmoins, les créateurs de ces contenus ont toujours trop tendance à oublier une partie significative des internautes: les personnes en situation de handicap. Un constat préoccupant, car ce sont tout autant les créateurs que les viewers qui en pâtissent.
La vidéo : une partie intégrante de l’accessibilité numérique
Depuis quelques années, la communication sur internet s’est fortement accentuée par le biais de vidéos aux formats multiples. Qu’elles soient informatives, amusantes, pédagogiques ou percutantes, ces vidéos se sont au fil des années immiscées dans notre quotidien numérique.
Les hébergeurs de ces contenus multimédias sont aujourd’hui nombreux. Les réseaux sociaux comme Instagram, X (ex Twitter), TikTok ou Facebook, sans oublier YouTube, en sont les porte-étendards. De par leur usage massif, il paraît donc évident que rendre ces contenus vidéo accessibles à tous revêt une importance capitale pour garantir l’égalité d’accès à l’information.
L’accessibilité des contenus vidéo en ligne s’inscrit donc dans les obligations de l’accessibilité numérique. Une accessibilité qui doit aller au-delà des limites physiques, linguistiques et cognitives, permettant à chacun, indépendamment de ses capacités, de bénéficier pleinement des contenus audiovisuels en ligne.
L’accessibilité vidéo, c’est en effet pousser à l’inclusivité en offrant des sous-titres pour les personnes malentendantes ou des descriptions audio pour les malvoyants, par exemple. C’est aussi d’autres outils, ou plus d’options de paramétrages, pour différents handicaps, élargissant ainsi l’audience et offrant une expérience équitable à tous. C’est également répondre à des exigences légales visant à garantir une accessibilité universelle des contenus en ligne.
Comprendre les obstacles à l’accessibilité des contenus vidéo
Pour rendre ses contenus vidéos accessibles à tous, il ne suffit pas d’ajouter uniquement des sous-titres comme évoqué précédemment. Les difficultés à la lecture d’une vidéo peuvent être nombreuses, et nous ne les avons pas forcément toutes en tête lorsque nous produisons un contenu vidéo destiné à être publié sur internet. Afin d’avoir une idée plus large des problèmes qui peuvent être soulevés, examinons les principaux troubles rencontrés par les utilisateurs. Liste non exhaustive.
Les déficiences visuelles
Les personnes atteintes de déficience visuelle peuvent rencontrer plusieurs problèmes lorsqu’elles essaient d’accéder à du contenu vidéo en raison de leur condition.
Parmi ces problèmes, il y a :
- l’absence de descriptions audio : Les utilisateurs atteints de cécité ou malvoyants peuvent avoir du mal à comprendre le contenu d’une vidéo si elle ne contient pas de descriptions audio.
- Le contraste insuffisant : Un faible contraste entre le texte et l’arrière-plan peut rendre difficile la lecture de tout texte s’affichant à l’écran pour les personnes rencontrant des difficultés de perception des contrastes.
- Une police de caractères inadaptée : Un choix de police inadaptée, qu’il s’agisse d’une typographie difficile à lire ou d’une taille trop petite, peut compliquer la lecture du texte vidéo, notamment pour les personnes ayant une vision réduite.
Les déficiences auditives
Voici quelques-uns des problèmes courants auxquels les personnes ayant une déficience auditive peuvent être confrontées.
- L’absence de sous-titres : L’absence de sous-titres ou de transcription peut rendre le contenu vidéo totalement inaccessible pour les personnes sourdes ou malentendantes. Les sous-titres sont donc essentiels pour comprendre le dialogue et suivre le déroulé d’une vidéo.
- Des sous-titres incorrects ou mal synchronisés : Des sous-titres incorrects ou mal synchronisés peuvent compliquer la compréhension du contenu. Ils doivent être précis, bien synchronisés avec l’audio et représenter fidèlement le dialogue.
- Des sous-titres sans distinction de catégorie : Il est important de créer des sous-titres qui se distinguent entre eux. En effet, les sous-titres d’un dialogue ne doivent pas avoir la même police d’écriture, ou la même couleur, que les sous-titres d’une action qui n’apparaît pas à l’écran, sous peine de causer une incompréhension pour l’utilisateur.
- Une faible qualité sonore : Une mauvaise qualité sonore ou un son de faible volume peuvent rendre difficile la perception du dialogue ou des sons importants dans une vidéo pour les personnes ayant une déficience auditive.
Les déficiences motrices
La déficience motrice peut aussi poser plusieurs problèmes en matière d’accessibilité vidéo, limitant la capacité des personnes concernées à interagir, à naviguer et donc à bénéficier pleinement du contenu vidéo.
- Une navigation difficile : Les personnes en situation de handicap moteur peuvent rencontrer des difficultés pour naviguer dans les lecteurs vidéo en raison de la nécessité de mouvements précis pour contrôler les fonctionnalités telles que la lecture, la pause, la modification du volume ou l’avance rapide. Par ailleurs, les interfaces vidéo elles-mêmes peuvent ne pas être optimisées pour une accessibilité maximale, pouvant rendre difficile la visualisation ou la navigation.
- Le manque de personnalisation des commandes : Les options limitées pour personnaliser les commandes ou ajuster les paramètres de lecture peuvent rendre l’expérience vidéo inaccessible pour ceux ayant des besoins spécifiques en matière de contrôle.
- L’absence de technologies d’assistance compatibles : Certains lecteurs vidéo peuvent ne pas être compatibles avec les technologies d’assistance utilisées par les personnes ayant des limitations motrices.
La résolution de ces problèmes liés aux déficiences de motricité incombe cependant plus au site internet qui publie la vidéo qu’aux créateurs de contenus.
Les déficiences cognitives
Les troubles de l’attention, de la mémoire ou du comportement peuvent compliquer la lecture des vidéos. Par exemple, des mouvements brusques de caméra, un trop grand nombre d’animations ou des sous-titres qui apparaissent mot par mot peuvent rendre la compréhension difficile et diminuer l’accessibilité pour ces personnes.
- La difficulté de concentration : Les personnes atteintes de troubles de l’attention comme le TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité) peuvent avoir du mal à se concentrer sur de longues vidéos. Il peut être alors difficile de suivre un contenu vidéo, surtout s’il est complexe ou exigeant en termes de concentration.
- Les problèmes de traitement de l’information : Les troubles de l’attention et de la mémoire peuvent entraîner des difficultés à assimiler rapidement les informations visuelles et auditives présentes dans une vidéo, ce qui rend la compréhension du contenu plus difficile.r d’un objectif commun et d’actions concrètes.
Bonnes pratiques d’accessibilité numérique pour les contenus vidéo
En France, on estime que plus de 14,5 millions de personnes, de 15 ans ou plus, sont en situation de handicap. C’est donc autant de personnes possiblement concernées par la nécessité de l’accessibilité des contenus vidéo en ligne. C’est pourquoi il est important de penser à l’accessibilité de votre vidéo dès sa phase d’ébauche.
Voici les trois bonnes pratiques principales à mettre en œuvre pour répondre au respect des critères du RGAA:
Le sous-titrage
En premier lieu, il faut distinguer les sous-titres de traduction des sous-titres destinés aux personnes sourdes et malentendantes, qui ne poursuivent pas le même objectif. Le sous-titrage qui nous intéresse doit toujours être rédigé dans la langue de la vidéo concernée.
Sur de nombreux réseaux sociaux, les sous-titres automatiques sont désormais omniprésents, mais ils sont souvent imprécis, mal synchronisés ou difficiles à lire. Pour garantir une accessibilité optimale, il est donc préférable de créer vos propres sous-titres. Affichez, via un texte situé en bas de l’image, tous les textes vocalisés de votre vidéo. Adoptez une police simple et lisible, avec une taille assurant un confort de lecture. Veillez à ce que vos sous-titres soient parfaitement synchronisés avec le flux vidéo et différenciez les sources sonores (différents personnages, voix off…), par exemple en utilisant des crochets, de l’italique ou une mention explicite telle que « voix off ».
Il est important de ne pas incruster les sous-titres directement dans la vidéo, mais de les associer à un fichier texte indépendant, afin qu’ils puissent être activés ou désactivés depuis le lecteur. Si le lecteur ne propose pas cette fonction, envisagez de proposer deux vidéos : l’une sans sous-titres et l’autre avec sous-titres, hébergées sur des pages distinctes. L’essentiel étant que l’utilisateur identifie facilement l’existence d’une version accessible.
La transcription textuelle
Rédigez une retranscription complète, chronologique et textuelle décrivant la totalité de ce qui est exprimé oralement dans la vidéo et de toutes les informations descriptives nécessaires à une compréhension équivalente de l’action. La transcription peut également être complétée d’éléments permettant d’en enrichir le sens comme des liens ou des images.
De plus en plus de plateformes proposent aujourd’hui des transcriptions automatiques générées par intelligence artificielle, mais celles-ci sont souvent imprécises, tronquées ou mal structurées, ce qui peut nuire à la compréhension et à l’accessibilité. Pour garantir une réelle accessibilité, il est donc recommandé de relire et corriger ces transcriptions, voire de les créer manuellement si nécessaire.
Gardez à l’esprit qu’une transcription textuelle constitue un texte organisé, similaire à tout autre texte écrit. En fonction de vos besoins il est recommandé d’employer des listes, des titres ou d’autres éléments structurants. La transcription textuelle peut être positionnée immédiatement sous la vidéo avec une description claire mais peut aussi se trouver sur une page distincte joignable via un lien sous la vidéo.
L’audiodescription
Apportez une description sonore à insérer entre les moments de dialogue de votre vidéo. Le but de l’audiodescription est d’assister les individus avec des déficiences visuelles en leur transmettant les détails qui ne peuvent être saisis uniquement par l’ouïe.
L’audiodescription d’une vidéo doit donner des détails sur les personnages et leurs actions, sur les transitions de scènes, le texte affiché à l’écran et sur les éléments visuels importants. Cependant, si toutes les informations de la vidéo sont déjà transmises à travers la piste audio, l’audiodescription ne sera pas nécessaire. Comme pour les sous-titres, n’intégrez pas directement la piste d’audiodescription à la vidéo mais associez-la grâce à un fichier audio distinct afin d’être activable et désactivable.En appliquant ces trois grandes lignes de conduites, vous respectez une partie des normes multimédias imposées par le RGAA et contribuez à rendre l’accessibilité numérique concrète et à même de toucher une plus large audience. Vous pouvez néanmoins soutenir vos efforts par le biais d’initiatives complémentaires..
Améliorer l’accessibilité de vos vidéos : nos recommandations complémentaires
Vous avez mis en pratique nos recommandations précédentes et souhaitez pousser davantage l’inclusivité de vos contenus vidéos ? Retrouvez ci-dessous quelques conseils supplémentaires pour plus d’accessibilité.
- Même si l’inclusion de la langue des signes n’est plus un critère testé par le RGAA 4, elle reste un élément essentiel pour l’accessibilité vidéo, notamment pour les personnes sourdes ou malentendantes. En effet, la langue des signes demande moins d’effort de concentration que la lecture de sous-titres et permet une compréhension plus directe du contenu. Pour garantir une visibilité optimale, le cadre de la personne qui signe doit être suffisamment grand, occupant idéalement au moins un tiers de l’écran. Veillez également à dégager suffisamment d’espace dans vos cadrages et à positionner le cadre dans un coin, généralement en inférieur droit, sans masquer d’information importante de la vidéo.
- Dans le cadre d’une vidéo dans un style interview face caméra, assurez-vous que le visage de la personne filmée soit bien visible en optant pour un éclairage de bonne qualité. En effet, certains viewers ont une déficience auditive et lisent sur les lèvres.
- Comme indiqué dans la section de sous-titrage, optez pour une police d’écriture simple et assez grande pour faciliter la lecture. Veillez impérativement à respecter des contrastes et des couleurs appropriés entre le texte et l’arrière-plan afin de garantir une visibilité optimale des sous-titres. Ne multipliez pas les différences de couleurs pour les sous-titres, les personnes atteintes de daltonisme pourraient ne pas les distinguer.
- Évitez les lumières clignotantes et autres effets stroboscopiques. Certains internautes peuvent être sujet aux crises d’épilepsie. Toute lumière clignotante à une fréquence de plus de trois fois par seconde doit être évitée.
Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et entamer un accompagnement pour la mise en accessibilité de vos projets numériques incluant, ou non, du contenu vidéo.